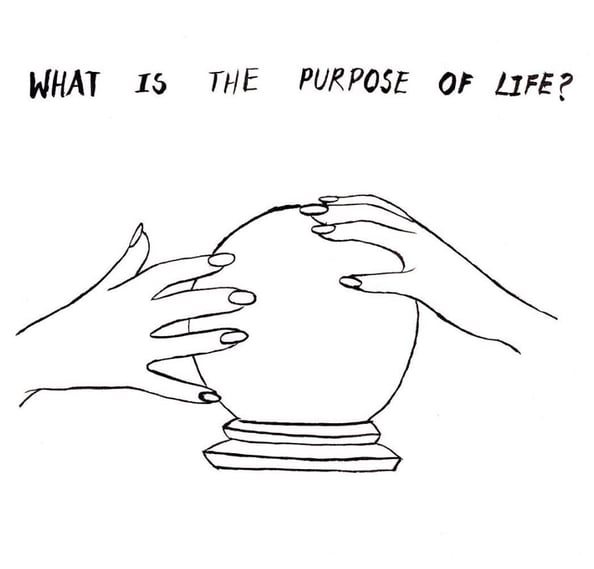JE SUIS ... ARRÊTÉE
Performance, vulnérabilité & temps de l'arrêt


”Naps don’t help when your soul is tired”. No, they don’t.
C’est ce que j’ai appris à mes dépens en avril dernier, quand j’ai été arrêtée pour burn out.
De mon expérience du temps de l’arrêt, des sentiments contradictoires, des interrogations politiques et une autre appréhension du temps - comme substance élastique - ont émergé peu à peu, et c’est ce que j’essaie de raconter dans ce premier Mood.
—
Spoiler : c’est environ 20 minutes de lecture, parce que je n’avais pas forcément envie de créer du contenu “efficace” qui se digère aussi vite qu’il se lit 🤭Et pour une meilleure lecture, si tu ouvres ce texte dans ton inbox : clique sur “ouvrir dans le navigateur” en haut de cet email, ou directement sur ce lien pour me lire sur la plateforme Kessel.
—

Le burn out, ou la cerise qui cache le gâteau
”Dommage d’en être arrivée là”, “t’es en burn burn ou juste fatiguée ?”, “c’est peut-être un mal pour un bien” (non), … Autant de remarques entendues en pagaille suite à mon arrêt, qui donnent parfois l’impression que le burn out est la version 2.0 de la Rolex des cool kids parisiens. Et si t’es pas déjà en burn out, t’es quasi-certainement en surcharge cognitive - c’est Marie Pezé, docteure en psychologie et spécialiste du sujet, qui le dit ! Pas mal de se le rappeler en plein dans cette période souvent chargée de début d’année.
Avant de vivre un burn out, les différents témoignages de personnes ayant traversé une expérience similaire ne m’intéressaient que moyennement, ou de loin. Je ne me sentais pas concernée car j’avais l’impression que ça arrivait un peu à tout le monde, donc que ce n’était pas si grave, et en même temps que ça ne m’arriverait pas. Aujourd’hui, les récits de burn out sont de plus en plus nombreux. Ils ne me passionnent toujours que très peu (been there, done that), mais leur multiplication atteste d’une vérité collective difficile à balayer sous le tapis : 2,5 millions de salariés sont en burn out sévère (sans parler des autres), soit 13% des salariés.
La réalité individuelle est - elle aussi - dure à ignorer. Même si je ne compte pas faire dans ce texte un récit de burn out, il me semble bon d’en rappeler les contours. Les contours justement, Judith Duportail les trace dans cet épisode dédié de l’excellent podcast Self-Care ta mère. Si quelqu’un de votre entourage est concerné.e, je vous conseille d’y jeter une oreille. Marie Pezé, citée plus haut, n’y mâche pas ses mots : ”Lors d’un burn out, les cellules du cerveau ne se re-polarisent plus normalement, le fonctionnement organique du cerveau est atteint, il y a une désorganisation qui n’est pas seulement intra-psychique.” Il s’agit d’un “syndrome d’effondrement de toute la personnalité.” (Oups). Bref, un gros bordel intérieur.
Ou comme j’ai pu l’écrire avec le plus grand lyrisme en mai dernier :
“Avant, j’étais confiante en moi et en l’avenir, j’avais de l’ambition et de l’énergie (beaucoup) pour les deux. Maintenant, je suis flottante, sans but. Il y a quelque chose de cassé à l’intérieur. La tristesse se mélange à beaucoup de fatigue, les deux me débordent. Il n’y a pourtant plus grand chose à faire déborder vraiment. Je me demande si je dois faire tomber les derniers remparts et plonger dans un coma infini (le rêve), alors même que ce sont eux qui me tiennent debout et me permettent encore de ressentir des miettes d’émotions positives.”
C’était donc : la grande forme !
On pourrait croire que tout cela se vit individuellement, un maxi drame à l’échelle mini de l’intime, un évènement isolé lié à une faiblesse passagère de la personne. Cependant, ce qui m’intéresse ici, c’est ce que ce phénomène dit de nous comme société, à échelle collective. Il semble évident que le burn out n’est qu’un symptôme de l'inflammation généralisée que nous vivons. Celle des corps, des esprits et de la planète : la partie émergée de l’iceberg d’une culture de la performance et de la productivité, au service d’une croissance infinie et accélérée, imposée à nous et qu’on impose en retour à nous-mêmes et aux autres.
Adapte-toi et le ciel t’aidera
Le problème avec un tel iceberg, c’est qu’il semble être le seul à ne pas fondre, complètement insensible aux effets du réchauffement climatique dont il est pourtant à l’origine. Je me suis donc demandée quelles forces le maintenaient, car si c’est une chose de vivre la performance, c’en est une autre de la comprendre. Barbara Stiegler, philosophe française brillante, spécialiste de philosophie politique et nouveau girl crush en date, a su brillamment éclairer ma lanterne avec un angle que je n’avais pas envisagé. Attention, on rentre dans le dur.
Elle a enquêté pour nous sur l’origine de la compétition permanente que nous vivons, qui est en fait due à une forte influence du darwinisme social dans le débat économique néolibéral des années 30. Le courant a été promu notamment par Walter Lippmann, un peu malgré lui (cimer gros), qui met en avant le besoin pour tout organisme de s’adapter face à un environnement qui évolue plus vite que lui. Une sorte d’octogone permanent entre vous et le monde. On en a typiquement retenu la fameuse règle du “survival of the fittest”, la survie des plus aptes, et logiquement, l’élimination de fait des plus faibles (ceux qui, par exemple, ne traverseraient pas la rue pour trouver du travail 🤡).
Sans toujours nous en rendre compte, nous vivons donc partout et tout le temps dans cet univers mental aux fondements biologiques, qui nous est devenu naturel. De là vient, selon Barbara Stiegler, une injonction contemporaine majeure : “il faut s’adapter à un environnement en mutation permanente” pour gagner le jeu économique et social. Barbara Stiegler nous précise :
Ce qui me frappe, c’est le fait que l’on vive dans un monde imprégné de cette injonction permanente à l’adaptation, à la sélection, à la compétition, à l’évolution, etc., mais que tout cela ne soit pas pensé. On est imprégné de toute cette histoire intellectuelle, sans en avoir conscience. Ce sont des idées diffuses, dont on ne saisit pas la signification.
Cette pensée dominante, dont elle a retracé l’origine, imbibe aujourd’hui le néolibéralisme en lui servant d’appui, jusqu’à infiltrer les mots choisis dans le discours contemporain, notre vision du politique et du monde.
Se désadapter pour échapper à la tyrannie du présent
Toutefois, dans ce paradigme de pensée, l’individu conçoit donc son environnement comme détaché de lui, un horizon qui recule sans cesse plus vite à mesure qu’il avance, et sur lequel il n’a pas prise. Dans ce discours, les transformations et actions que nous opérons sur cet environnement sont occultées. Mais est-ce qu’en m’adaptant je ne crée pas justement les conditions qui vont accélérer les crises et renforcer le besoin d’adaptation, jusqu’à épuisement ?
Ce hamster qui court dans sa roue, Jérôme Baschet, historien, le nomme “tyrannie du présent” . Pour lui, tout l’enjeu vient de notre rapport au temps. Nous serions figés dans un sentiment d’urgence quotidien qu’il appelle “présentisme”. Mais en nous adaptant constamment, nous ne faisons justement qu’amplifier le phénomène, qu’exacerber la compétition, les injonctions, et l’accélération. Peut-être que le meilleur moyen de faire face aux défis actuels serait donc justement de se désadapter. Apprendre de nouveaux modes de faire, d’être, et surtout : changer son rapport au temps. C’est donc ce dont je voulais parler ici.
“Brûler le feu” : Juliette n’est pas la seule à performer sur scène
Je pense que j’ai arrêté de culpabiliser de mon burn out quand j’ai commencé à le politiser et à conscientiser mon arrêt comme un temps de résistance à l’adaptation. J’ai habité cet arrêt comme une brèche temporelle à contre-temps des injonctions de performance, de productivité et d’accélération continue du monde. L’exploration d’un repli dans une toile d’habitude constamment tendue. Un repli qui - dès le début -m’a obligé à “être” plutôt qu’à faire ou devenir, puisque ma capacité à me projeter même à court terme avait disparu, par manque d’énergie. J’étais donc de nouveau cantonnée au présent, mais sur un mode bien différent de celui de l’urgence. Non seulement je n’avais plus de projets pour la suite, mais je n’étais moi-même plus un individu en projet d’une meilleure version de moi, toujours plus épanouie et accomplie.
J’étais pourtant à deux doigts, tenez vous bien, de rater mon burn out. Je ne l’optimisais pas à des fins de reconnexion à un moi “authentique”, je n’en profitais pas non plus pour m’aligner avec mes valeurs profondes, trouver un sens, voire LE sens, découvrir mon “féminin sacré”, ou encore consoler mon enfant intérieur. C’est incroyable comme la pause, et l’arrêt de façon plus générale, deviennent eux-mêmes des performances. On a - et moi la première - du mal à leur accorder une valeur intrinsèque, et à s’auto-valoriser dans le non-agir, parce qu’on ne nous l’enseigne pas.

D’ailleurs, quand on sort de ce “mode du faire”, cela perturbe aussi l’entourage : quoi demander à quelqu’un qui ne travaille pas ? Il semble que cela réduise le champ des conversations possibles aux repas de famille, sans parler du small talk en soirée, qui se polarisent le plus souvent autour des accomplissements passés ou à venir. En vivant cette pause, j’ai pourtant le temps de vivre une extension de mes réflexions, de plonger les mains dans la pagaille qui m’habite, j’aurais donc beaucoup de choses à exprimer.
Soulever la latte du plancher émotionnel
Aller plus loin dans l’être de quelqu’un, et pas dans la couche superficielle de son faire, cela demande souvent un effort marginal : entrer dans le territoire mouvant du secret, du non-dit, de l’émotion, des récits que l’autre se fait, ses rêves, doutes, chagrins, désirs, en accepter les nuances. Il y a une sorte de “plancher émotionnel” dans nos conversations (j’espère populariser ce terme, j’avoue) : creuser au-delà, c’est risqué de se rendre vulnérable(s) et d’être touché par l’autre. Est-ce que c’est aussi parce que cela nous donne une responsabilité ?
Parce qu’il y a bien sûr la performance en elle-même, mais aussi le récit de la performance. Comme si notre réussite s’écrivait surtout et presque uniquement dans le regard de l’autre : non pas au moment de faire l’action en elle-même mais plutôt à l’instant où je peux la raconter. Écrire une équation mathématique égale entre la valeur que l’on se donne et celle que les autres nous donnent, c’est aussi ça la performance.
Si on s’amusait (lol) aujourd’hui à taper trois coups de Brigadier sur le sol de nombreuses entreprises - et de nos vies de façon générale - les rideaux de velours rouges s'ouvriraient certainement sur une performance de la performance : huilée, rapide, répétitive, et surtout sans entractes. Je me demande même si être en échec aujourd’hui au yeux des autres, ce n’est pas un acte politique en soi ? Et là-dessus, merci Queen Mahaut, qui nous raconte les siens avec humour (je vous conseille son spectacle à La Nouvelle Seine pour beaucoup de paillettes et encore plus de cynisme.).
Le point de rupture comme ligne de départ
Bref, cet arrêt, et son acceptation, m’ont donc projetée de nouveau dans la temporalité de l’instant (et non de l’urgence, vous suivez toujours ?). Au début, cela a totalement chamboulé ma perception du temps et l’attention portée à moi-même et à mon environnement, comme vous pourrez le lire ci-dessous. J’y évoque la rupture vécue, l’arrêt soudain d’un rythme soutenu, et toute la dislocation temporelle qui en émerge en même temps qu’un certain vide.
Accepter la rupture, changer de régime temporel, tout cela permet de faire preuve d’une vraie résilience, et d’apporter du changement. C’est vrai à échelle individuelle, mais aussi collective. Et du changement collectif, nous en avons besoin plus que jamais. En voyant le mot résilience employé partout à tort et à travers, on pourrait presque croire que nous en avons déjà une dose suffisante. Mais la résilience proposée est-elle réelle ou seulement le cache-misère sémantique d’un système structurellement cassé ?
Il n’y a pas eu de début précis ou clair.
Pas ce court trait vertical en début d’une frise chronologique qu’on trace sur les bancs de l’école et qui indique : c’est là, et qui explique : c’est comme ça que ça a commencé.
Qui marque, net, les choses pour qu’on s’y retrouve, les ordonne et les range. Qui nous prend par la main et nous fait glisser le long d’une droite jusqu’à la flèche pour connaître la direction à suivre, le sens à donner.
Il n’y a plus de début à rien, le Temps pour moi s’étire maintenant comme un magma élastique. Les jours sont longs et les nuits plus longues encore, même si courtes. Tout est lent, se mélange. Le temps frémit à feu doux dans mon corps, une pâte épaisse et brûlante de jours, de mois, d’années, de souvenirs encore chauds qui consument la chair de l’intérieur et j’aime venir m’y brûler les cils.
Chaque matin, je prends en main le Temps, j’en aplatie la pâte noire sur la table du salon. J’observe les marbrures rouges incandescentes encore ouvertes, chemins tracés qui zèbrent les zones mortes en des motifs aléatoires et trompeurs ; j’essaie d’y voir une signification, en vain, et sûrement parce qu’il n’y en a pas. J’essaie de comprendre la diversité des trajectoires qui auraient pu se dessiner. Je choisis un point précis, je coupe, puis j’observe.
Que se serait-il passé en étirant par ici ? En tronquant ce coin-là ? Je travaille le magma-temps en y plongeant les mains d’abord, puis en m’y laissant ensevelir entièrement, seule façon de le façonner comme j’aurais voulu qu’il le soit. Je mets le passé dans le futur, le futur dans le présent, je colle ensemble deux failles, (…) Je crée une jolie forme, lisse, sans accrocs (…)
Ralentir, s’arrêter : ce qui permettrait de se reconnecter à soi-même, d’accepter le finitude des choses, d’expérimenter un autre mode d’être qui nous sort de l’impossible infini, de l’urgence. Ce qui permet aussi peut-être de récupérer en pouvoir d’agir sur le sens de la frise chronologique décrite, de proposer d’autres lignes, d’autres directions, de déplacer la destination et implémenter une véritable transformation.
Valoriser le corps, le collectif, et le corps collectif
Lors de mon arrêt, j’étais comme retirée par une main invisible de la répétition du quotidien, et mise dans un bocal avec un régime temporel ralenti à l’extrême. Dans une société qui s’organise autour du gain de temps et de l’action, se réapproprier son régime temporel est une curieuse expérience. Bien sûr, je connaissais en théorie tous les bienfaits individuels, mais aussi économiques et écologiques du ralentissement, ce n’est pas une recommandation nouvelle.
Néanmoins, percevoir la lenteur empiriquement, comme un état prolongé ou une façon d’être, c’est autre chose que la vivre comme une pause. Aujourd’hui, nous vivons principalement le repos par intermittence, au service d’une meilleure productivité future (les weekends, les vacances d’été pour se remettre de la fatigue puis la reprise, etc.). Cette deuxième option fait de notre bien-être non plus une fin en soi mais un moyen au service de plus de performance. Apprendre à ralentir autrement, cultiver les liens, prendre soin de soi, pour être plus à même de prendre soin des autres, repenser son rapport au corps et à l’inaction, c’est ce à quoi j’ai réfléchi ces derniers mois ;
🔥 1 - Habiter son corps, les sensations-signaux
On pense souvent nos émotions intellectuellement, sans forcément ressentir ce qu’elles déclenchent comme sensations corporelles chez nous. Plus je m’approchais du burn out, plus celles-ci sont devenues puissantes et évidentes : vertiges, nausées, picotements et fourmis, spasmophilie, déréalisation … Mais toute émotion, la plus subtile soit-elle, a des manifestations physiques, comme des indices. Il ne faut pas sous-estimer le dialogue entre le corps et les processus cognitifs, et je suis même persuadée maintenant qu’il faut l’investir plus, car ce sont des choses qu’on ne nous apprend que rarement à l’école. Je me demande par exemple pourquoi je n’ai découvert que tardivement la physiologie du système nerveux, le rôle du cortisol dans la régulation du stress, ou encore celui du nerf vague.
Texte sur le ressenti que l’anxiété déclenche en moi - principalement la gorge nouée, le manque d’air, des fourmillements dans les mains.
SENSATION
C’est niché juste là
Sensation subtile grandit
Large Elle grossit prend
Toute
la
place
dansmagorge
Comme une éponge avalée sèche
Enfoncée Elle s’imbibe
Loin dans ma trachée
Sensation absorbe tout
L’eau, l’air, la vie,
Elle
coule
Descend
Dans ma poitrine, Lentement
Sensation s’étend s’étire
Comme un miel violent
Et alourdit le coeur collant
Toi, tu aspires la Sensation
Tes lèvres sur les miennes
une goutte - après - l’autre
Pour ne pas laisser la peur,
Râpeuse épine
M’écorcher plus longtemps
Tu suces le venin le plus vite possible
En aspirer toute trace et le recracher
- Loin.
Ce que j’ai écrit peut être qualifié d’interoception. Il s’agit de tourner sa perception vers l’intérieur de soi, là où nous sommes entraînés à la porter majoritairement vers l’extérieur aujourd’hui. Se couper de ce langage corporel et de la lecture des sensations-signaux, c’est s’enlever la possibilité d’identifier un potentiel déséquilibre ou dysfonctionnement mental, de comprendre ses besoins. Cela peut sembler évident de prime abord, mais dans un monde accéléré et saturé d’informations, qui favorise l’intellect au détriment du corps, l'interoception est l’opportunité de vivre au bon rythme, d’absorber le présent et donc de devenir plus acteur de son régime temporel. PS : je vous vois les joggeurs sur Strava qui, certes habitent leurs corps, mais une fois de plus, cherchent la perf.
Cette gymnastique avec soi-même développe notre capacité d’empathie et donc notre possibilité d’établir des liens avec d’autres personnes. Julien Devaureix partage et analyse dans un épisode récent de son podcast Sismique certaines de ses peurs face aux crises actuelles. Parmi elles, l’apathie générale dont souffre le monde actuel, qui semble déconnecté de sa boussole interne. L’interoception c’est aussi s’autoriser à se connecter à sa colère ou à sa tristesse devant un certain état du monde et ne pas banaliser la violence qu’on observe au quotidien, qui est partout.
C’est laisser ses émotions vivre et se déployer, donc aller à l’encontre d’une culture du travail, et d’une culture tout court, virilistes ; qui encouragent un blocage des émotions et valorise l’individu insubmersible, sans faille (boys don’t cry, c’est connu). Ou à la limite qui permet une semi-vulnérabilité dans les limites de l’acceptable, une fois de temps en temps. C’est encore Bell Hooks qui en parle le mieux : « Apprendre à porter un masque est la première leçon de masculinité patriarcale qu’un garçon apprend ». On s’attendrit et on admire plus facilement la mise en scène d’une personnalité forte, qui a du succès, et qui nous fait l’honneur et le privilège à de rares occasions de nous convier dans son intimité et de lever un demi-voile pudique sur une fêlure, que l’inverse. Se reconnecter à son corps et ses ressentis, ça équivaut souvent à faire tomber le masque avec lequel on se regardait, ou on voulait être vu, pour pouvoir vivre ses différentes strates émotionnelles (au-delà de leur intellectualisation), mais aussi mieux comprendre celles des autres.
🔥 2 - “Perdre” du temps, ça n’existe pas

Alors que j’étais moins dans l’action pendant cette période d’arrêt (voire pas, on va pas se mentir), j’ai pourtant eu l’impression paradoxale de récupérer en capacité à agir sur moi et sur le monde. En ralentissant et en désaturant mon attention, sans le faire avec pour objectif ultérieur d’être plus efficace et plus rapide, je me suis rendue compte à quel point ma perception intérieure de la durée a pu devenir élastique et se décorréler du temps factuel des horloges.
Un peu comme le temps qui semble s’écouler différemment en été, la perception de celui-ci est devenue pour moi modulable à tout moment. Par une combine magique, j’ai donc réussi à prolonger la durée d’une minute en décidant d’y consacrer toute mon attention, et c’est comme ça que j’ai pu faire durer de courts cafés en terrasse quelques heures ; en créant à l’intérieur même de moi un nouvel espace-temps plus malléable. L’écrivain Michel Butor met - je trouve - des mots justes sur cette sensation :
Avec le passage des années, la conscience du temps se transforme et prend une autre valeur, on fait l’expérience d’une accélération. (...) Contre cette accélération surgit toutefois l’idée que l’on peut soi-même sécréter du temps. (...) La relation de l’individu au temps est donc bien plus active que ce que l’on a l’habitude d’imaginer.
“Sécréter du temps”. S’autoriser à ressentir l’épaisseur d’un instant, créer ses régimes temporels. C’est peut-être ça vivre l’expérience de la résonance, que propose le philosophe allemand Hartmut Rosa. Un concept faussement simple, qui parle de cette vibration ressentie quand se passe une connexion au monde, et qui pour lui est devenue une denrée rare dans un contexte hyper connecté et accéléré. En résumé, ce que nous dit notre pote Hartmut : cette résonance que nous recherchons, qui fait le sel de la vie, ne peut se trouver qu’en se heurtant à l’indisponible du monde, de l’autre - dans ce qu’on ne maîtrise pas ou pas totalement, dans ce qu’on ne comprend pas toujours, à l’instar de la neige qui nous surprendrait au petit matin. Sauf qu’aujourd’hui, on veut tout contrôler, maîtriser, gérer : l’emploi du temps et nos émotions aussi.
Notons toutefois que le rapport au temps est aussi culturel et social, évidemment. Tout ce texte est façonné depuis mon propre point de vue de parisienne, femme occidentale et privilégiée. Celles et ceux qui - comme moi peut-être - ont l'opportunité de se reposer, prendre des pauses, sont hélas aussi les mêmes personnes qui bénéficient du plus de privilèges (et ont donc le moins d’intérêt à créer un changement). Ce sont aussi celles et ceux qui ont accès aux soins qui permettent de contrebalancer les effets psychopathologiques de l’accélération. Si on tire le trait, peut-être que si nous vivions dans un monde sans accès aux palliatifs des loisirs et aux remèdes contre la fatigue, le stress, l’anxiété, la dépression, alors nous aurons déjà décidé d’un changement collectif plus grand.
🔥 3 - Ralentir pour ressentir, ressentir pour prendre soin
Selon moi, Marina Abramovic met magistralement en scène le ralentissement et ses bienfaits dans sa performance “The Artist is Present” au Moma en 2010. Assise au milieu d’une foule, elle invite les visiteurs à s’installer en face à elle en silence pendant aussi longtemps qu’ils le souhaitent. Elle reste ainsi plus de 736 heures, et à chaque nouvelle personne, la même magie opère, le public assiste à un corps à corps émotionnel : pleurs, sourire, rire. Paroxysme de la performance, lorsque Marina en levant la tête se retrouve face à Ulay, son ex boyfriend, après 20 ans sans se voir. Un moment d’autant plus fort qu’ils avaient choisi de concrétiser leur rupture de façon pas du tout engageante, à savoir un trek de trois mois, avec un départ chacun depuis un bout de la muraille de Chine, pour s’y retrouver au milieu et se dire adieu définitivement (vous trouviez votre dernière rupture dramatique ? Try again).
Au-delà du récit amoureux, la performance de Marina Abramovic met en scène de façon efficace les effets d’une distorsion de notre régime temporel sur nos émotions et notre empathie. Grâce au ratio long silence/inaction du show, la vulnérabilité apparaît. Chaque visiteur développe une plus grande conscience de ce qui est en train de se dérouler, mais aussi de ses pensées, et se laisse atteindre par le moment. Un lien se crée dans ce temps ralenti, qui devient finalement un terreau fertile pour aux dynamiques de coopération, hors de la compétition habituelle.
Faire face à des crises systémiques implique que chacun.e puisse en amont accepter son interdépendance au reste du système, et donc une certaine fragilité. On voit bien comment cela nécessite d’optimiser nos capacités à nous connaître, à comprendre l’autre, et surtout à prendre soin. Une société du “care”, qui fait du bien-être une question collective et politique, c’est la proposition de Carol Gilligan. Le souci ? Le care est majoritairement porté aujourd’hui par des femmes, dans des métiers peu valorisés socialement et financièrement, voire du travail effectué gratuitement dans la sphère familiale.
Contrairement à la compétition dont parlait Barbara Stiegler plus haut, et qui domine aujourd’hui, l’entraide est omniprésente dans le monde du vivant et a permis à de nombreuses espèces de survivre. François Taddei, biologiste de l’évolution, en parle (et ce n’est pas le seul) ici. Les bactéries survivent en coopérant et en échangeant de l’information, donc en mettant en oeuvre l’intelligence et la décision collectives pour résoudre des problèmes ouverts aux dimensions nombreuses, mouvantes, et complexes (ça vous rappellera peut-être les caractéristiques d’un problème comme celui, au hasard, du réchauffement climatique).
🔥 4 - Créer de nouveaux espaces
Si je débute l’un des textes ci-dessus par l’image de la frise chronologique, ce n’est pas un hasard. Elle incarne à la fois un écoulement régulier du temps qui passe, mais en fléchant la direction lui donne aussi une direction linéaire, qui induit un sens particulier - une signification : nous nous dirigeons vers ce but-là. Être piégé dans une temporalité spécifique, ou plutôt dans un certain régime temporel, qui est celui de la société actuelle, c’est aussi de façon sous-entendue être enfermé dans une signification qu’on nous impose. Ralentir c’est multiplier les possibilités de lignes d’horizon de cette frise.
Déborah Lévy dans son roman La Version nous parle d’un peuple étrange et poétique qui a développé son propre sens, et donc sa propre perception du temps :
Ils savaient quand accélérer et quand ralentir. Ils savaient interrompre et relâcher, cesser et poursuivre. Jamais trop tôt, jamais trop tard. (...) Ce qui ne veut pas dire qu’ils contrôlaient le temps, exerçaient sur lui un pouvoir, non ce n’est pas ça. S’ils étaient capables d’une si grande dextérité temporelle, c’est qu’ils connaissaient les rythmes et les cycles. Je ne veux pas dire qu’ils avaient sur tout cela des informations, mais qu’ils les éprouvaient. Personnellement, concrètement. J’ai compris un jour que s’ils se donnaient les moyens de tout cela, c’est parce qu’ils savaient une chose que j’ai longtemps ignorée. Les erreurs de temps sont une source de désastres.
Elle continue en nous expliquant à quel point le lexique de ce peuple pour désigner des périodes, cycles, temps différents est exhaustif et fouillé. Ils créent des espaces dans le langage qui eux-mêmes ouvrent de nouvelles possibilités dans l’imaginaire. Aujourd’hui, j’ai parfois l’impression qu’on manque d’espaces linguistiques pour repenser notre rapport au temps et au monde, mais aussi d’espaces tout court. D’espaces physiques, intellectuels, imaginaires, créatifs, à ouvrir encore et encore comme autant de possibilités qui permettent d’imaginer et de créer autre chose. Mais aussi peut-être d’espaces éducatifs : comment apprendre ces métacompétences, apprendre à ne rien faire, à valoriser le soin, apprendre l’empathie, apprendre la résilience : une sorte de pédagogie de la rupture.
Ce n’est pas un hasard si les tiers-lieux connaissent un tel succès : il y a un besoin de créer des brèches à rebrousse-temps pour plus de liant, et du corps à corps affectif entre les individus. Ces nouveaux espaces individuels, collectifs, publics permettent de faire émerger entre moi et l’autre des situations ou des problématiques communes, puisqu’ils autorisent et permettent la vulnérabilité. Émergent alors des publics qui se ra/e/ssemblent, qui ont pris le temps du dialogue pour établir un diagnostic commun, voire une émotion collective, qui réussissent à politiser leur analyse de la situation, et qui peuvent dès lors se mobiliser pour faire bouger les lignes. Être acteur de son temps, c’est aussi être acteur du récit que l’on écrit, du sens que l’on donne.
Certaines émotions ou actions ne se vivent que dans le ralentissement ou dans l’arrêt (sur image) : l’émerveillement, la contemplation, peut-être même le sentiment amoureux, l’écoute, l’imprévu, la rêverie, l’ennui, la poésie ou encore la douceur. La créativité et l’imagination, deux qualités qui semblent essentielles face à la complexité et au chaos actuels pour dessiner d’autres types de futurs, ne peuvent souvent naître que dans le temps long également. Elles demandent d’accepter de se laisser atteindre, comme Eric Faye l’explique dans Mes Trains de Nuit :
C’est dans les trains et notamment dans ceux de nuit, qu’a pu s’épanouir mon besoin de lenteur. […] À bord du train, la lenteur n’est plus coupable, elle n’est pas non plus un luxe. Faire ne rime plus à rien, ne mène à rien. […] À bord des trains du soir et de la nuit s’instaure une paix étrangère à tout affairement. La lenteur a offert à la rêverie le train comme prolongement du banc, du fauteuil à bascule, du parapet d’un phare, du chemin de ronde, où l’on flâne à l’affût d’un projet, à l’affût de l’impossible enfin atteignable.
Alors, s’interroger : est-ce que je m’autorise à ne rien faire d’autre qu’être, ou est-ce que je cherche à rentabiliser jusqu’à mes trajets en train ? Quand est-ce que je me suis autorisé à être vulnérable dernièrement et auprès de qui ? Est-ce que j’autorise les autres à l’être avec moi ? Quand est-ce que je me valorise et selon quels critères ? Combien de choix ai-je fait par volonté de performance ? Est-ce je ne ressens jamais certaines émotions par manque de temps ? Suis-je aliéné par les injonctions induites par mon rapport au temps ? Quand est-ce que j’agis intentionnellement sur celui-ci ? Qui suis-je quand je ne suis pas en train de performer pour les autes ? De performer pour moi-même ? Quels espaces j’ouvre dans le monde ?
Le temps de l’arrêt, du non-agir, correspond à des modes d’être laissés en friche chez de nombreuses personnes, qui sont pourtant autant de conditions sine qua non à une véritable résilience collective. Vivre ce temps-là, c’est ouvrir une brèche, créer une rupture, et accepter la possibilité d’autres espaces temporels. C’est sortir de l’adaptation permanente et retrouver un rôle d’action sur son environnement. C’est piétiner la frise chronologique linéaire et immobile, refuser une fin imposée et la signification qui va avec pour en penser d’autres.
À celles et ceux qui lisent ces lignes et leur trouvent peut-être un caractère utopique et idéaliste, je leur dirais d’aller faire une sieste. Même si ça ne suffit pas, c’est un bon début.
- Kiss :)
🤓 BIBLIO POUR ALLER PLUS LOIN - LES REF CITÉES OU NON
En attendant des recommandations culturelles à voir, lire, écouter qui arrivent dans 15 jours, voici déjà quelques références qui ont inspiré ma réflexion :
J’avais beaucoup aimé cette tribune (article payant) de Julien De Sanctis, qui y aborde sa dépression, un état d’être qui - comme le burn out - est difficile à décrire. C’est d’autant plus important d’en parler que l’OMS prédit que la dépression sera la première cause d’invalidé dans le monde d’ici à 2030.
Le monde avait cessé de me nourrir (..), je me trouvais dans l’incapacité totale d’en mordre la chair et d’en récolter la sève. (..) La dépression est un flétrissement. Elle vous recroqueville brutalement, assèche votre goût, étouffe votre désir (..) Il n’y que vous et votre solitude, vous et cette souffrance d’une violence absurde.
Hartmut Rosa, Rendre le monde indisponible : l’expérience de la modernité se résume pour Hartmut Rosa à celle de l’accélération permanente. Il en explore les différentes facettes, propose une critique sociale du temps, et de la façon dont celui-ci impacte aujourd’hui négativement notre rapport au monde en nous aliénant. Pour se relier de nouveau au monde, il préconise d’entrer en résonance. Un essai simple et accessible, qui prend la forme d’un manifeste et nous met face à nos contradictions.
Claire Marin, Rupture(s) : comment penser notre identité dans les accidents de vie, si l’identité même existe. Claire Marin retourne nos chairs à vif pour en disséquer les plaies de la façon la plus poétique qui soit. La rupture peut permettre selon elle de corriger une dissonance cognitive que beaucoup vivent entre leur quotidien et leur ressenti profond. Entre intime, philosophie, psychologie, on navigue de questions en problèmes existentiels. J’ai adoré cette lecture, le genre de pages à feuilleter à différentes étapes de sa vie.
Camille Teste, Politiser le bien-être - Camille Teste commence son livre avec cette citation de Léon-Paul Fargue que j’adore : « J’appelle bourgeois quiconque renonce à soi-même, au combat et à l’amour, pour sa réussite. ». Penser le bien-être autrement, apprendre à fonctionner autrement c’est ce que propose Camille Teste, dans son livre, sur son insta, avec son podcast mais aussi pendant ses retraites de yoga, que j’ai eu la chance d’expérimenter. Elle nous plonge dans “des pratiques qui nous apprennent à ralentir, à cultiver le repos et à savourer l’oisiveté (..) qui réapprennent au corps le réflexe du non-agir.” Son livre est ultra complet sur la question, accessible et plein de chouettes références. Il nous incite à nous questionner sur le lien entre rapport de domination et émotions, et présente comment le bien-être peut et doit être un outil politique d’émancipation.
Débora Levyh, La Version : ce livre, le premier que je lis de l’autrice, m’a été recommandé par une plume que j’apprécie et dont j’espère vous recommander bientôt le premier roman. Elle m’avait dit “ça se mange un peu comme un gâteau dont on arrive pas à définir le goût”, et c’est vrai. Le récit m’a séduite par son style singulier, sa poésie déroutante, ses descriptions onirique. L’intérêt se trouve plus dans l’empreinte laissée dans mon imaginaire que dans une signification rationnelle, il faut se laisser porter. On y découvre les moeurs et habitudes d’un peuple inconnu dont les repères sont éminemment différent des nôtres. Qui dit autre façon de vivre, dit autres façons de penser.
Une “société du care”, qu’est-ce que cela veut dire ? Mieux le comprendre en écoutant par exemple par ici Fabienne Brugère sur France Inter ou en lisant la définition de Joan Tronto : « Activité caractéristique de l’espèce humaine, qui recouvre tout ce que nous faisons dans le but de maintenir, de perpétuer et de réparer notre monde, afin que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde comprend nos corps, nos personnes et notre environnement, tout ce que nous cherchons à relier en un réseau complexe en soutien à la vie » (Un Monde vulnérable. Pour une politique du care.) Il s’agit de repenser le lien social autour du soin, et la façon dont celui-ci est institutionnalisé aujourd’hui dans la société.
Le Soi Ecologique, concept dont m’a parlé récemment Manon Sala en me racontant sa thèse, qui nous vient tout droit de Norvège par Arne Næss. Je ne connaissais ce terme, qui fait pourtant écho à tout ce que je raconte ci-dessus. Le philosophe norvégien est aussi à l’origine du mouvement de “deep ecology”, et préconise un lien affectif au vivant (s’identifier en tant que pair aux autres formes de vie terrestres), au-delà de celui d’un rapport de domination ou gestion. Peut-être l’une des mes prochaines lectures ?
Barbara Steigler, Il faut s’adapter : à retrouver dans cette interview Thinker view et dans cet article très complet, qui éclaire son propos.
Mais aussi : Jérôme Baschet, Défaire la tyrannie du présent - cet épisode du podcast Sismique avec François Taddei, chercheur en génétique moléculaire évolutive et médicale & en éducation - la notion d’androcapitalocène proposée par Catherine Albertini, spottée dans cette longue et riche biblio par Bérénice Gagne - ces deux épisodes d’un Podcast à soi sur l’écoféminisme, mis en ligne en 2019 mais ultra complet - les articles du blog de l’école Sadhana : Charlotte Multon y explique les liens entre neurosciences et yoga, mais aussi concrètement les mécanismes cérébraux et physiologiques pour mieux réguler stress et anxiété.